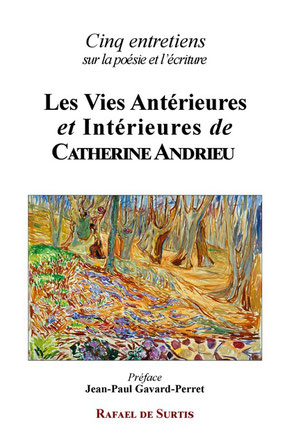
Entretiens
Les vies antérieures et intérieures de
Catherine Andrieu
Entretiens conduits par Jacqueline Andrieu, Étienne Ruhaud, Éric Chassefière et Jean-Paul Gavard-Perret
Extrait de la préface de Jean-Paul Gavard-Perret
Les entretiens de Catherine Andrieu peuvent se lire comme les mannequins ou les partitions de ses livres. Ils montrent comment une vie peut en contenir d'autres
et comment l'écriture se met à les revivre. La créatrice s'y montre telle qu'elle est : revenante et vivante dans un clair obscur là où sa propre histoire contient bien des coffrets à secrets.
Ceux-ci dans son œuvre deviennent des contes aussi oniriques que vrais. Ici - se défendant de toute figure de "beau parleur" - la créatrice soulève le couvercle de son existence à côté de ses
textes de vie, de songe. Dans les deux cas se découvre une femme complexe aussi lunaire que solaire et dont les mots simples touchent plus que l'éloquence et ce, en des remémorations_-miroirs.
Elles sont le fait de la dernière surréaliste. Donc la première.
Extrait des entretiens, réalisé par Étienne Ruhaud, paru dans Le Portulan Bleu, n° 38, mai 2022.
1. Plusieurs recueils sont illustrés par tes propres peintures. Tu es à la fois plasticienne, poétesse, et musicienne, comme l’indique le titre Piano sur l’eau.
Établis-tu une correspondance entre ces trois activités créatives ?
J’établis d’abord une distinction entre la création et la seule interprétation. Le piano, c’est mon travail. Bien sûr c’est faux, mais je veux dire que j’y
travaille, avec la notion d’hygiène, de régularité, d’effort et de progrès. Je ressens, c’est étrange peut-être, que le piano fait appel à une intelligence scientifique, mathématique,
intelligence à laquelle je n’ai plus accès dès lors que je suis préoccupée. Le piano m’a accompagnée toute ma vie, même quand c’était sous la modalité d’ « être sans » piano, qui n’est qu’une
forme d’ « être avec ». J’ai commencé enfant. Mais je n’ai jamais créé, même si j’ai une belle musicalité. Le piano ainsi conçu est pour moi parfois une contrainte, et je ne peux en rien le
comparer à mon œuvre de plasticienne et de poète. La musique est pour moi une forme de méditation et d’ascèse. Pour ce qui concerne mon œuvre plastique, je l’ai abandonnée il y a plusieurs
années, ce qui ne veut pas dire que je n’y reviendrai pas, mais disons que c’est par le contact avec la matière (je peignais souvent avec les mains) que j’ai retrouvé les racines les plus
profondes de ma créativité. A vingt ans j’étais une jeune intellectuelle, et j’avais, dans mon écriture, perdu la spontanéité que je pouvais avoir quand je ne me comparais pas encore à Nietzsche
ou Heidegger. A vingt-six ans un ami d’enfance s’est suicidé et ça a été cataclysmique dans ma vie. J’ai eu besoin de retrouver un ancrage dans ma sensorialité et n’ai pu le faire qu’en peinture,
où je n’avais pas de préjugé, avec une naïveté sans doute confondante pour quelqu’un qui aurait appris les arts. J’ai fait néanmoins de nombreuses expositions, à Paris et dans les Ardennes. Mais
je ne me sentais pas toujours vraiment « légitime », ni non plus en accord avec une culture contemporaine hyper expérimentale, installations et vidéos. Pour finir, je me suis mise à écrire comme
je peignais, et j’ai retrouvé la spontanéité de mes quinze ans. L’écriture me suffit. A six ans j’étais poète. C’est comme ça, un don, ça ne s’explique pas. L’écriture est mon
territoire.
2. Dans un précédent recueil, tu évoques le physicien et penseur Stephen Hawking[1]. Par ailleurs, tu es philosophe de formation et tu as publié un ouvrage sur
Spinoza[2] Là aussi, te sens-tu marquée, lorsque tu écris, par ta formation de philosophe ?
Oui, sans aucun doute. La philosophie m’a apporté la rigueur et la logique dont je manquais. Elle a complètement structuré mon écriture. Mais elle m’a fait
perdre mon identité propre stylistiquement pendant des années. C’est pour ça qu’il m’a fallu, après huit ans d’études, passer par la peinture, telle Mary Barnes avec ses excréments. J’ai en effet
inventé une façon de m’exprimer au carrefour de toutes mes influences : forme un peu « affectée », surannée parfois, mélangée d’oralité, de culture populaire et de ce qui me constitue dont je
n’ai qu’une vague idée. Mon Spinoza date de l’époque « philo », il est très ardu. Quant à l’astrophysicien Hawking, c’est très différent : je suis tombée éperdument amoureuse de cet homme ! Je me
suis passionnée pour sa recherche et sa vie et j’ai écrit sur lui : un recueil entier, et un poème seul dans « Piano sur l’eau ». J’ai toujours pensé que l’intelligence était érotique. Et Stephen
Hawking était très, très intelligent.
3. Refuge, journal de l’oubli, est dédié à tes chats Paname et Lune, que tu déclares aimer passionnément (Oui, je t’aime, ma petite Lune, je t’aime
infiniment, p. 28). Comment expliques-tu cet attachement aux félins ? Te sens-tu plus proche du monde animal ?
Je suis fondamentalement antispéciste. Ce n’est pas parce que j’aime les animaux, c’est parce que je les respecte, comme dit Aymeric Caron. Je ne donne pas dans
l’anthropocentrisme. Les seuls animaux que j’aime vraiment sont les félins. Je crois qu’ils me fascinent parce qu’ils sont dangereux. Les chats aussi sont dangereux, les vétérinaires en ont
souvent peur. Un chat ne fait que ce qu’il veut, et j’aime cette liberté. Mais, bien que j’aie des chats depuis l’âge de quatre ans, je ne les ai pas tous aimés également. Avec Paname, dont je
parle dans « piano sur l’eau » et « Refuge, journal de l’oubli », j’ai vécu une passion folle et douloureuse. Je n’ai jamais pu penser à lui sans anticiper sa disparition. Il était une petite âme
vivant à mes côtés. Il était mon amour absolu, je ne peux rien ajouter à ça. Quant à Lune, elle est arrivée il y a peu dans ma vie, c’est encore un bébé chat mais déjà avec un gros caractère
!
4. Pour autant, les êtres humains sont bel et bien présents dans ton livre, qui constitue une série d’hommages appuyés à tes anciens amoureux, à ton éditeur,
l’éclaireur Paul Sanda (p. 33), à tes proches. Ainsi, Refuge, journal de l’oubli, constitue-t-il en quelque sorte une galerie de portraits, une autobiographie ?
Je crois que ton analyse est très juste, que ce journal, cette galerie de portraits comme tu dis, est en réalité une forme d’autobiographie, et je suis
coutumière du genre. Pourquoi ai-je parlé de ces personnes-là en particulier, je n’en peux rien dire consciemment, mais il y a sûrement un fil d’Ariane, quelque chose qui échappe. Il y a des
images comme des leitmotiv dans mon œuvre, et quelques personnes qui reviennent jusque dans Refuge, c’est le cas de mon père qui a une problématique avec la mémoire, d’où le titre. Je voulais
vraiment rendre hommage à mon éditeur Paul Sanda, parce qu’il est extraordinaire, et qu’il me guide sur mon chemin d’auteur, parce qu’il Voit ce qui me restait obscur. Il est souvent à chaque
étape de ma création. En particulier pour ce recueil, Refuge, le texte avait vaguement des qualités, mais c’est Paul qui a vu la forme que ça allait prendre. Sans lui j’étais foutue
!
5. À ce propos, pourquoi parler de journal de l’oubli ? La mort est très présente dans ton recueil et tu fais souvent allusion à des amis disparus, notamment
un enseignant ou un camarade de classe suicidé. Est-ce pour garder mémoire, pour garder trace, que tu écris ? Tu cites la formule de Borges, en guise d’épilogue : qui parle de concave mémoire
humaine (p. 35).
Ce qui me fascine et me tourmente, c’est l’ultime respiration dans le passage de vie à trépas. Elle contient en elle le Mystère de la vie dans son entier, et
davantage peut-être. C’est très banal de dire ça, affligeant, mais je retiens de ma formation qu’être philosophe c’est souvent s’interroger comme un enfant à propos d’un monde auquel l’on ne
s’habitue pas. Je suis hantée par la mort, complètement. Comme je suis malade psychique et très fragile, j’ai souvent attiré des personnes qui l’étaient tout autant que moi, et trois de mes amis
se sont suicidés avant l’âge de trente ans. De façon moins brutale mais tout aussi tragique, j’ai perdu, comme tout le monde, des êtres chers, de maladie, parfois au terme de grandes souffrances.
L’absurdité apparente de la vie est aussi la beauté et l’éphémère, et j’ai eu l’occasion, grâce à un chat, de faire une expérience surnaturelle il y a peu. Tout ça me laisse à penser que le
hasard n’est que le point de vue de notre ignorance. Je ne crois pas en un Dieu anthropomorphique bien sûr, mais je crois en une forme de persistance de l’âme. Mais oui, pour répondre à ta
question, il s’agit d’un journal contre l’oubli, l’écriture comme ce refuge où je peux encore vivre un peu avec mes souvenirs et mes morts. Je pense pouvoir dire que mon œuvre est de bout en bout
anamnèse. Et aussi que je suis incapable, ou à peu près, de légèreté (rires).
6. Tu alternes prose et vers libres. Tu as par ailleurs, par le passé, pratiqué le vers régulier, en hommage à un père amateur de littérature classique. Où te
sens-tu le plus à l’aise ?
Je pense que les récits que j’ai publiés aux éditions Rafael de Surtis, regroupés dans « Des nouvelles du Minotaure ? », sont ce que j’ai fait de mieux, et ne
sont pas, à proprement parler de la poésie, à l’exception de « Hawking ; Etoile sans origine ». J’aime la prose, je la préfère aux vers libres, bien que ceux-ci me soient plus faciles. Les vers
rimés, non, je n’aime pas du tout, bien que j’aie donné dans ce style en hommage à mon père et sous pseudonyme.
7. La couverture de Piano sur l’eau représente la mer, vue depuis ton balcon. Tu as longtemps vécu dans la capitale avant de déménager pour Royan, au bord de
l’Atlantique. Tu évoques parfois l’élément marin. Ce changement de lieu a-t-il joué un rôle décisif dans ton écriture ?
Oui, j’ai vécu dix-huit ans à Paris, et m’y suis sentie complètement inspirée, absorbée par une forme de noirceur et de goût pour la provocation. Je voulais
défier les dieux. La sexualité y tenait une bonne place, mais bien sûr ça n’était pas l’essentiel de cette fantasmagorie poétique débridée. En revanche, d’un point de vue plastique, mes dessins
numériques sur photographie (qu’on retrouve sur mon site) formaient un vrai ensemble érotique qui, paradoxalement, plaisait énormément aux galeristes. J’étais influencée, jusque dans mon
écriture, par une esthétique underground. Mais sur les photos mes femmes avaient quelque chose de la petite fille violée, et dans mes textes le plaisir était humiliant. J’avais la rage contre
l’entité qu’on appelle Dieu, mes amis étaient morts et le ciel déserté. Quant à moi, j’étais malade. Les trois dernières années j’ai publié une dizaine de textes, mais je ne sortais plus de chez
moi. J’ai décidé de rejoindre mes parents à Royan, une nuit où j’ai été hospitalisée pour la Covid. Je revenais aux sources et revoyais la mer, moi qui avais grandi en Méditerranée, fille du
soleil et de la mer. Les couleurs ne sont pas les mêmes, et Royan ne sera jamais Collioure ; c’est ma jeunesse qui s’en est allée. Mais mon appartement donne sur le port et la pleine mer comme on
le voit sur la couverture de « Piano sur l’eau », c’est complètement hallucinant, idyllique. Avec la présence de la mer, j’ai retrouvé la petite fille qui courait sur les rochers, son innocence
et sa pureté. Et c’est avec ça, après une longue imprégnation, que je me suis (re)mise à écrire, d’abord « Piano sur l’eau » puis « Refuge, journal de l’oubli », et c’était si pur et si
différent. Il y est toujours question de la mémoire et de l’oubli, du souvenir et de la perte, beaucoup de mes chats aussi, mais je n’aurais pas pu écrire comme je l’ai fait sans le mouvement des
marées. C’est du moins ce que je crois si j’en juge par la magie du lieu... Et les fées lumineuses qu’on y rencontre la nuit (rires).
8. Sur la couverture de Refuge, journal de l’oubli, figure Christ enfant méditant, tableau attribué à Mathieu Le Nain. Un de tes livres s’appelle J’ai commencé à
dessiner des anges [3] ; et tu qualifies à plusieurs reprises tes chats d’anges. Te sens-tu mystique ? Ta poésie possède t-elle une dimension métaphysique ?
Quand j’étais enfant, ma maman, qui est très pieuse, me disait que les morts portaient des ailes, et je trouvais ça magique : ça expliquait pourquoi ils
pouvaient rester au ciel sans tomber (rires) ! Ma sœur, quant à elle, croit que nos chats sont nos anges. Et moi, en bon auteur, j’absorbe ces croyances pour en faire un objet poétique. Si tu me
demandes si j’y crois je dirai non, absolument pas, bien que j’aie réussi, et je ne demande pas à ce qu’on me croie, à entrer en contact avec mon chat Paname quelques minutes après sa mort. Toute
ma vie j’ai attendu ce signe, et il est venu de l’être dont j’ai été le plus proche ces treize dernières années. A présent je n’ai plus peur de la mort. Pour te répondre enfin, non, je ne me sens
pas mystique, et ma poésie, qui est profonde je crois, a une dimension non pas métaphysique mais existentielle. La figure du Christ, néanmoins, m’interroge et m’intéresse
beaucoup.
9. On sent, dans ta poésie, une souffrance à la fois psychologique et physique, puisque tu y évoques à la fois la maladie mentale et la dégradation du corps.
Vois-tu, précisément, la poésie comme un exutoire ? Penses-tu, comme L.F. Céline, qu’il faille mettre ses tripes sur la table ? Derrière cette mélancolie, cette nostalgie, pointent parfois des
instants de joie. Te sens-tu parfois heureuse quand tu écris, ou heureuse d’écrire ? Penses-tu qu’écrire permette d’échapper au désespoir ?
Il faut dire que pour moi la dégradation psychologique a induit la dégradation physique, puisque mes antipsychotiques m’ont fait prendre beaucoup de poids. Ça
n’est pas si facile à vivre dans une société de l’image et de la comparaison, a fortiori lorsqu’on vous compare à celle que vous avez été. J’étais une très jolie jeune fille qui a été aimée
globalement pour de mauvaises raisons, je m’en suis aperçue rétrospectivement. La vraie lumière, c’est maintenant que je la partage avec les gens. Pour me décentrer un peu, tout le monde a des
incidents de parcours ou bien vieillit tout simplement. Je crois que le Sens, vraiment, c’est ça : apprendre à se dépouiller de ce qui n’est pas essentiel. Sinon il n’y a que dans la vieillesse
qu’enfin la société vous lâche, comme le disait Deleuze. Je n’ai pas le goût de la poésie formaliste, hermétique ou trop intelligente. D’ailleurs je n’ai pas d’avis sur ce qu’est la poésie ni si
elle peut changer le monde. J’ai juste besoin de m’exprimer et je le fais, avec un certain soulagement et parfois jusqu’à l’épuisement car je travaille très vite, mais souvent avec joie. Oui, je
mets mes tripes sur la table, beaucoup trouvent ça naïf (quand je parle de mes chats par exemple) ou indécent, ça n’est ni bien ni mal, c’est.
[1] Hawking ; étoile sans origine, Rafael de Surtis, 2018.
[2] De l'éternité du mode fini dans l'Ethique de Spinoza, L’Harmattan, Paris, 2009.
[3] Rafael de Surtis, 2020.
> Pour commander, par chèque ( 19 euros, port compris ) :
Éditions Rafael de Surtis
7, rue Saint Michel
81170 Cordes-sur-Ciel
FRANCE
Éditions Rafael de Surtis