Critique de
Dana Shishmanian
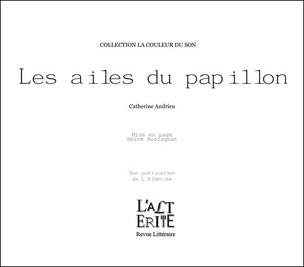
Les ailes du papillon
L’altérité, maison d’édition en ligne, mars 2024 (38 p.)
Ce recueil illustré par les peintures de l’autrice est un cri, une vie mise à nu, une déchirure de l’être livrée à vif sur la page – et l’on comprend vite que les
mots sont ici des fées guérisseuses ou plutôt, que l’âme secrète elle-même des mots tel qu’un ver à soie, son fil et son cocon – pour se réparer, se nourrir, se protéger… mais aussi pour que sans
même qu’il le sache, des tissus enchanteurs puissent naître de son fil et généreusement s’offrir à la vue des autres. Ces autres qui sont aussi bien source de souffrance pour soi (comme pour
eux-mêmes) et raison de vivre, brèche indispensable, accroc-crochet pour s’accrocher à hors-soi – peut-être pour se sauver tout en se perdant – et de cette contradiction structurelle et en soi
insurmontable naît sans complaisance mais tout doucement, comme un glissement, un début de chemin, un parcours paradoxal, une danse funambule sur le tranchet de la lame… : c’est le poème.
Quelques éclats particulièrement poignants de ces fulgurations :
Mon vide. J’étais celle qui ne sait pas qui elle est.
L’on me disait profonde, mais la surface seule faisait ma profondeur.
Il m’a fallu l’ascèse de vingt ans de souffrance à crever
Pour regarder l’abîme en moi.
Je suis celle qui écrit. Ce que je suis ?
J’ai passé toutes ces années dans une chambre sans toit
Et la pluie a rincé mon maquillage.
Je suis laide. (p. 9)
…Il m’a fallu des années pour rassembler le puzzle de mon âme... Chaque jour c’étaient des hurlements, tu défonçais les murs et tu partais... J’allais te chercher dans ta petite chambre
d’étudiant, quitte à dormir à quatre heures du matin sur ton paillasson : Je n’arrivais pas à te toucher. (p. 13)
…J’aurais dû te faire confiance, jeune Tirésias, c’est avec le cœur
Qu’on voit bien mais mon miroir était brisé dilemme schizophrénique
Ce qui est beau chez Narcisse, c’est qu’à la fin il se transforme en fleur. (p. 19)
…Je te regardais nouer et dénouer tes longs cheveux bouclés, je les arrosais jour après jour, c’était beau avec ton teint olive. Quand je maquillais tes yeux en amandes, légèrement bridés, tu
ressemblais à une fille et j’avais envie de te frapper. Je crois que je ne t’aimais pas, enfin pas vraiment, parce que tu ne me caressais pas, enfin pas vraiment... Entre toi et moi, l’Histoire
de la philosophie dans son entier et la nécrose de ton esprit. Vois ce qu’ils ont fait de toi : un caillou. Moi je n’aimais qu’ “Ainsi parlait Zarathoustra”, et Spinoza parce qu’il disait qu’on
ne reproche pas à une pierre d’être aveugle, et aussi en raison d’une inclination panthéistique. On faisait une belle paire de philosophes ! (p. 31)
…Tu aspirais au calme j’étais la fureur. Maniaco-dépressive
Au moins on sait. Nous étions trop jeunes et nos ailes brisées.
Au bord de mon océan, libre comme la mouette je me prends
À rêver à toi, à nous, l’universitaire que tu es devenu
Et moi qui n’ai que mes poèmes, ma bohème et ma mélancolie... (p. 33)
Dana Shishmanian

Initiations et Des griffes d’obsidienne
www.francopolis.net
Ces deux petits recueils se succèdent d’un seul trait d’inspiration, agencée selon des procédés de construction similaires, tout en développant en fait deux
branches différentes, stylistiquement parlant.
Comme l’indique son titre, Initiations se compose d’expériences initiatiques transcrites comme autant de visions oniriques qui, on dirait, amènent le « personnage-sujet » à l’état de conscience
où le monde spirituel l’accueille et la transforme, au-delà des limites de l’être terrestre ; alors que Des griffes d’obsidienne constitue, on dirait, la saga légendaire du « personnage-témoin »
de ses propres exploits métamorphiques : « l’enfant de la lune » en quête de vérité s’est changée en « sorcière qui tisse les étoiles ». La continuité est évidente car l’univers
symbolique-totémique est le même – le chat, la panthère, le lion mystiques : autant de figures génuines de cet alter-ego qu’est l’amant(e), entraînant l’enfant-femme dans une danse magique comme
ultime mystère de la vie et de la mort. On passe ainsi d’une intériorité « lyrique » vécue, à une extériorité « épique » contemplée – qui nous laisse lire, par des à-coups, par des recréations
successives, en tâtonnements, palimpsestes et variantes, une et la même « histoire », s’avérant en fait une histoire de double (l’enfant blonde / l’enfant brune, les âmes-sœurs entrelacées).
Cependant, l’un et le même monde imaginaire, autarcique voire narcissique, entraîne dans ses profondeurs le lecteur, qui ne peut que se laisser séduire par la ferveur que la poétesse met à le
faire surgir. J’ai choisi quelques bribes illustrant ce voyage… « chamanique ».
Initiations
La poupée n’est pas seulement de porcelaine. Elle est un peu sorcière, un peu magicienne. Elle sait invoquer les éléments, les faire danser à sa guise. La pluie devient son voile, la tempête
son manteau. Elle murmure des incantations oubliées, et les éclairs zèbrent le ciel en réponse. Son chat, fidèle compagnon, se métamorphose en panthère noire, gardien des mystères qu’elle porte
en elle.
I. L’éveil. iii. La sorcière
Dans l’obscurité de la nuit, leurs âmes se cherchent, tissant des fils invisibles à travers les distances. Lui, perdu dans la forêt dense, sens le murmure des arbres, les secrets qu’ils gardent
depuis des siècles. Elle, face à l’Océan déchaîné, entend les vagues rugir, portant en elles la promesse d’un amour mystique.
IV. La métempsychose
Quand la danse prit fin, l’enfant était changée. Son croissant de lune brillait plus intensément, et dans ses yeux, on pouvait voir les étoiles. Elle avait compris la magie de la forêt, la
puissance du lion, la danse de la vie et de la mort.
VI. La légende
Des griffes d’obsidienne
L’univers, vaste ventre d’une mère cosmique, les enveloppe. L’enfant sent les éléments se former autour d’elle. La terre durcit, les arbres s’élèvent, les courants la portent, et le vent caresse
son visage. Tout est en gestation, tout est naissance.
II. Dans la matrice du cosmos
L’enfant blonde, curieuse et avide d’aventures, a entendu parler de cette légende. On dit que la femme rayonne comme une déesse, sa chevelure argentée capturant la lumière des étoiles. Quiconque
croise son regard perd la vue, mais en échange, il reçoit le don de clairvoyance. Une étrange équation cosmique, un échange de sens pour la connaissance.
IV. Le secret
Toi, ma sœur réincarnée en panthère brune, tu portes en toi la magie des anciens rituels. Tes yeux reflètent les étoiles, et ton souffle est un sortilège. Les saisons défilent, et chaque
changement est une incantation.
IX. Sous la Lune des Enchantements
La légende grandit, portée par le vent, murmurée par les étoiles. On dit que les deux sœurs, aveuglées aux choses du monde, voyaient ensemble. Elles étaient les gardiennes du lac, des âmes liées
à jamais. Et quand la brume se levait, on pouvait les apercevoir, main dans la main, se perdant dans la forêt mystique, là où la réalité et le rêve se mêlent.
X. La genèse
Catherine Andrieu, Les griffes d’Obsidienne, Préface de Patrick Cintas, Rafael de Surtis éditeur, 2024, 40 p. — 18,00 €.
Catherine Andrieu, Initiations, Préface de Patrick Cintas, Rafael de Surtis éditeur, 2024, 40 p. — 19,00 €.

Ce qui pousse dans le silence
Poétesse mais aussi critique de poésie (voir son espace de publications dans la revue en ligne RAL,M et aussi, dans nos Annonces, son récent recueil Constellations critiques), Catherine Andrieu
nous présente mieux que quiconque les deux cycles de poèmes qui composent ce livre. Qui, nous avertit-elle d’emblée ; « n’est pas un recueil » : il est vivant tel un corps, « un seul organisme,
qui respire ».
Voilà donc avant tout un extrait de l’« avant-dire » au Ce qui pousse dans le silence :
« Il fallait le silence pour que cela pousse. Le silence, non comme absence de bruit, mais comme milieu matriciel. Le silence comme humus du verbe. Comme l’espace où les morts écoutent, où les
dieux se retirent, où le poème enfin peut devenir bête. Et semence. »
Et pour preuve, deux extraits des poèmes 6 et 7 de ce cycle qui en comporte 11 :
Et j’ai compris que le silence
n’était pas une absence,
mais une forme aiguë de présence.
Une présence retournée, comme un gant.
Le poème s’est mis à battre sous mes côtes.
Il ne disait rien.
Il devenait.
Un pur devenir,
comme un fruit qui éclate de trop mûrir.
Les 9 Chants d’une femme-transfiguration, dont l’avant-dire nous révèle que chacun « est une métamorphose » – « pas du corps-désir, du corps jouissance, du corps-image », mais « du corps-séisme,
du corps-matrice, du corps-totem » – témoignent en effet, dirait-on, de quelques magiques transformations. Elles nous font penser aux anciens mythes célébrés par Ovide, mais ici, dans un vécu
presque mystique : la femme au Corps-arbre, la Pierre Amante, la femme-flamme brûlant d’un Feu Transfigurant, la Bête, le Corps-Fontaine, la Parole Cendre…
Et quand le feu retombe –
car il retombe –
tu n’es pas morte.
Tu n’es pas vide.
Tu es pleine
de quelque chose de rare.
Un silence dense.
Une lecture en empathie de ce livre vivant vous transforme vous-même, lecteur, lectrice, tant l’écriture en est envoûtante, entraînant l’esprit et les sens dans une commune expérience au cœur de
l’âme du monde…
Catherine Andrieu, Ce qui pousse dans le silence, Éditions Rafael de Surtis, 2025.
www.rafaeldesurtis.fr

Le Royaume sans murailles, suivi de L’aurore intranquille
Ce recueil (signalé à notre rubrique Annonces / Recueils), comme d’autres œuvres de cette poétesse singulière, semble évoquer pour certains une sorte de panthéisme naturiste, féministe et
extatique, porté par un narcissisme tenace et issu d’une démarche volontariste assimilable métaphoriquement à l’alchimie, à la magie, voire au chamanisme… Certes, de telles suggestions peuvent
être légitimées par le texte. Mais la poésie de Catherine Andrieu est sûrement et définitivement autre chose, elle devient autre chose avec chaque nouveau recueil – et leur accumulation accélérée
prouve qu’elle est propulsée de plus en plus loin dans sa quête. Car c’est d’une quête de soi qu’il s’agit, non forcément recherchée mais tout d’abord subie, ensuite acceptée, et enfin, sinon
maîtrisée, certainement reconnue et exprimée comme telle. Se « perdre dans le grand Tout » n’est point ici « fusionner avec la Nature » – d’ailleurs la nature n’a rien à voir avec cette poésie
dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle tire son inspiration profonde de concepts très anciens qui font des quatre « éléments », si obsessivement évoqués par la poétesse – notamment le feu,
mais aussi l’eau, l’air, la terre – des principes psychiques et nouménaux, et non des principes physiques.
Cette poésie est alors celle où « les mots ne cherchent pas à nommer l’indicible, ils le laissent danser », comme le dit l’auteure dans son « avant-dire » du premier volet du recueil, Le Royaume
sans murailles. En citant Henri Michaux (« Je suis né troué. À travers moi l’air passe »), elle assume pour sa part une écriture dont les pages « sont traversées », dont l’espace est « sans
murailles », et l’amour – « immense et sans limites ». Elle invite le lecteur à rentrer avec elle dans un « miracle (…) : entendre, dans le fracas des éléments et la délicatesse d’un cil qui bat,
l’unique chant du monde ». Les 11 chants qui suivent s’adressent en effet à un ou des lecteur(s) – anonymes ou non (certains dédicataires étant appelés sur le mode dialogal, révélateur lui aussi
d’une esthétique, parfois en réplique) : la poétesse se fait initiatrice en dévoilant sa propre quête, aux accents presque mystiques. En voilà quelques indices remarquables :
Là,
dans le pli le plus humble de l’instant,
je t’aimerai jusqu’à t’inventer des ailes (p. 14)
Alors je m’allonge dans l’échancrure du jour (…)
et j’apprends,
sans plus chercher,
à devenir passage. (p. 16)
ce tumulte clair où rien ne fait mal,
où tomber est encore danser. (p. 18)
…j’ai vu danser des papillons
faits du tremblement même de l’air. (…)
Ils étaient ce qu’on devient
quand on ne veut plus rien être. (p. 24)
Je suis montée, moi, frisson de plume,
sur la dernière idée d’un arbre. (p. 29)
Sous les arches de braises éteintes,
je glisse, je disparais. (p. 33)
Mais la partie la plus intense, la plus dépouillée d’accessoires figuratifs, la plus aboutie aussi, poétiquement parlant, de ce livre magnifique est L’aurore intranquille, composée de 15 poèmes
titrés (les titres eux-mêmes valant chacun un poème) suivis d’un Épilogue réunissant à lui seul 30 poèmes numérotés, tous plus beaux les uns que les autres.
On parcourt ici, avec la poétesse, une aventure de libération des liens du monde, de retrouvailles de racines plus anciennes encore, d’« un silence plus vaste que ma mort », jusqu’à la cession de
tout avoir, jusqu’à être « ce rien qu’on ne garde pas / et qui reste » (Je rends tout aux éléments, p. 42).
Alors, dans l’échancrure du vide,
un œil immense s’ouvre –
non pour voir,
mais pour laisser passer l’éclair. (p. 45)
Elle évoque alors « un feu sans cendre ni répit, / un feu de passage, de suture, / un feu qui éclaire sans absoudre » (p. 47), et aussi « une rivière / qui n’attend jamais la mer / mais qui sait
dire l’ici (p. 49) ; « levée dans l’oubli d’un oiseau », elle se tient « dans l’instant suspendu entre le souffle et la chute » (p. 54), « là où le cœur bat pour ne pas rompre / ce fil / entre
l’absence et l’encore » (p. 80) – et dans « la chambre où le vent s’endort », elle découvre « une clef qu’aucune serrure n’a jamais attendue » (p. 57). La révélation se fait simplement,
humblement ; « il n’y a plus de ciel. Juste des débris de Dieu sur les dalles. » (Cendres d’aurore, p. 59). Et la grande envolée n’est pas un départ, mais une rentrée : « Voyage ? / Il est là, il
est déjà là, / dans l’immense palpitation / de rester » (Ici, l’immense, p. 68). Car « à l’endroit du jaillissement », « chaque battement d’aile / arrache un morceau de miroir au silence » :
alors, « qui saisit qui ? » (pp. 72-73).
Dans ce témoignage enstatique se révèle aussi le sens de l’écriture comme expérience paradoxale. En répondant à un lecteur (« Vous disiez : vous écrivez trop »), la poétesse confie (dans Les
miroirs de Narcisse sont parfois en grève) :
Ce n’est pas une maladie,
c'est une marée montante,
une faim sous la peau,
c’est l’ongle qui gratte la paroi de la nuit
jusqu’à en faire une phrase (p. 75)
Rien n’égale, dans ce livre, le poème final. Cet Épilogue en 30 stations est à réciter à voix basse et claire dans un lieu sacré, où l’on ne vient « pas (…) pour recevoir » mais « pour (se)
perdre » ; car « se perdre, ici, / c’est renaître » (p. 84). Dans cet espace mystique on lève les bras « non pour prier » mais pour se « suspendre / comme un fruit au bord de la chute » ; au
milieu d’un « bleu ancien » (hölderlien), « qui n’a jamais appris à être couleur, / seulement blessure lente, vérité sans contours », on aimerait « entrer dans le ciel / comme on entre dans l’eau
», mais on « reste ici, (…) à parler au vide / comme à un frère muet » et on « laisse la peau regarder…/ cette peau fine, / poreuse, / qui s’ouvre à l’intérieur / comme une oreille ancienne »
(pp. 85-86). Le dépouillement – y compris dans l’ordre du langage poétique, réduit à une extrême efficacité, par la simplicité même – est total. Car « il faut perdre la langue / pour qu’elle
devienne souffle » (p. 91).
Je n’ai plus de nom.
Je suis une chambre d’écho,
Une main ouverte
Où repose le silence. (p. 87)
C’est là que j’écris.
Non depuis le sommet,
mais depuis la fêlure. (…)
Il y a dans mes mains
un feu que je ne commande pas.
Il écrit. (…)
J’ai longtemps voulu guérir.
Puis j’ai compris que c’était dans la plaie
que naissait la lumière.
Pas à côté.
Pas au-delà.
Dedans. (pp. 88-89)
L’épuration de l’être mène alors à un néant vivifiant :
« la forme la plus haute de l’être :
un abandon vibrant,
qui épouse tout
et ne retient rien.
Je me tiens là désormais,
dans ce rien qui palpite.
Et j’apprends à devenir
ce qui reste
quand tout s’efface. (p. 94)
Cela s’appelle aussi apprendre à vivre le miracle (« Je n’attends plus le miracle. / Je vis dedans ») : or « Le miracle, / ce n’est pas ce qui sauve. / C’est ce qui reste / quand on ne cherche
plus à être sauvé ». (pp. 96-97) Y a-t-il de l’amour là-dedans ? Oui :
Et peut-être est-ce là
Le plus grand don :
N’être plus que seuil
Où l’amour
Se risque. » (p. 99)
Citer c’est montrer combien on aime ; je ne peux finir qu’en citant entièrement le poème qui clôt cet Épilogue :
Je ne sais plus si j'avance
ou si je me tiens.
Mais je brille.
Pas comme un phare.
Pas comme un soleil.
Comme une braise
sous la peau du monde.
Rien ne me distingue.
Je passe,
comme passent les herbes hautes
dans la lumière du soir.
Mais je sais,
au plus nu de mon souffle,
que j'ai touché
ce lieu sans contour
où l'être s'accorde
à la vibration du réel.
J'ai été silence,
j'ai été feu,
j'ai été l'effroi et la traversée.
Aujourd'hui,
je suis ce qui reste
quand on a tout laissé.
Je suis cette lueur
au bord de l'effacement,
ce battement calme
qui, sans bruit,
s'obstine.
Je ne cherche plus rien.
Je ne garde rien.
Je ne crains plus la fin.
Car même si tout se retire,
même si le nom s'efface,
même si le corps se fond dans la poussière —
je demeure lumière. (pp. 118-119)
Le Royaume sans murailles. Suivi de : L’aurore intranquille, Éditions Rafael de Surtis, juillet 2025 (118 p., 17 €)