Critique de
Daniel Brochard
Quand les drames de l’existence surviennent, écrire devient un moyen d’endiguer les flots du malheur. Il s’agit d’assimiler la perte. Dès lors, l’écriture est un acte chamaniste, une passerelle entre la vie et l’au-delà. Rien ne trouve signification sans son contraire : la nuit le jour, le rêve la réalité, la vie la mort… Des données aussi simples sont sans cesse questionnées, tant il est vrai que les réponses se trouvent à l’intérieur de soi. L’être souffre, car rien n’est acquis. L’inconscient joue un rôle prépondérant. Etre signifie trouver son chemin dans les multiples dimensions de l’être. Cette quête est menée au fond de la psyché tout comme aux confins des étoiles. Les questions les plus essentielles sont posées. La maladie trouve son remède dans les arbres, les forêts, dans les effluves de l’océan. Car l’auteure baigne dans une sensibilité extrême. La violence des mots est à la hauteur de la souffrance engagée. Ecrire est un acte violent mais nécessaire, un passage vers une autre dimension. Ecrire doit changer la vie.
DANIEL BROCHARD
Hawking ; Étoile sans origine publié en 2018 aux éditions Rafaël de Surtis
Avec cette poésie cosmologique*, Catherine Andrieu nous offre une nouvelle exploration. A la manière de l’astrophysicien Stephen Hawking, décédé en mars 2018, l’auteure nous convie à un voyage aux confins des étoiles. Ici l’âme s’émerveille de l’Univers. Les distances infinies effectuées en quelques lignes… Ici l’ambivalence de l’esprit et de la matière, vide et atomes se répondent. Le monde se confond avec la voix : « Je porte mes larmes comme un collier d’aurore ». L’observation est toujours concomitante de l’expression intérieure. C’est la loi de la physique Quantique. L’expérience influence l’observateur et vice versa. L’homme se confronte à un impossible : « Je me cogne comme un oiseau fou aux barreaux de l’être, aux barreaux du monde… » Les interrogations humaines sont sans fin, la science n’éclaire qu’une partie du monde ! Hawking, le savant, se poste devant son miroir, devant des millions d’années-lumière, l’œil au télescope. Comprendre l’univers, c’est se comprendre soi : « Où es-tu, toi mon je ? » Car le cosmos est en nous : « Tu absorbes une partie de la lumière dans ton champ gravitationnel », « Je saigne mes dernières gouttes d’aube… » La Science parle aussi bien de nous-mêmes que des étoiles. Au-delà de la vulgarisation, l’auteure revendique son droit à la rêverie. Car l’Univers ne nous appartient-il pas ? Ne sommes-nous pas tous capables d’être émerveillés ? Les considérations sur l’Univers s’expriment par un dialogue entre les âmes. Les « trous noirs », sortes de gouffres invisibles au cœur des galaxies, sont aussi très présents dans ce long poème… Ne sommes-nous pas un fétu de paille dans ce monde, destinés à disparaître ! Le temps humain, si fragile, si bref n’est rien en comparaison de la force des étoiles ! Ici, la poésie est mise à l’épreuve. Les questions les plus fondamentales sont posées. La poésie s’appropriant le réel, le merveilleux ! Le « rayonnement d’Hawking » devient plus qu’une découverte cosmologique, c’est une source de poème ! Tout comme les océans sont le début de l’évolution, la Science actuelle est le début d’une longue aventure humaine. A travers ce voyage, Catherine Andrieu écrit une ode au merveilleux, mais aussi un chant où l’âme exprime sa souffrance. Le vide du cosmos est propice à toutes les interrogations. « Je suis femme, je suis folle… » Dans cette rêverie, le désespoir n’est jamais très loin. La poésie permet d’éclairer le monde terne et l’âme humaine. Comme cet Univers qui ne cessera de nous questionner… « Tu peux tout imaginer, et faire tous les voyages, Hawking, ghost in the shell… »
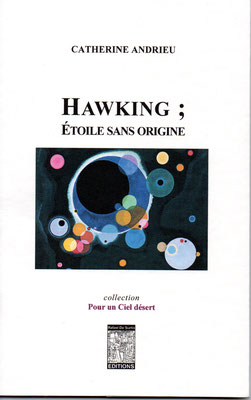
Seuls les oiseaux sont libres, publié en 2016
Troisième recueil de Catherine Andrieu publié par les éditions du Petit Pavé, cet ouvrage s'inscrit dans une seule thématique : la perte d'un chat. Ce micro-événement à l'échelle humaine déclenche un flot de tristesse et de douleur. C'est toute la vie qui repasse au fond des yeux, à l'instant où le drame se joue. Et c'est l'humaine faiblesse qui tremble devant la cruauté du monde. Ce recueil est un cri de douleur et de colère. A travers un événement banal, c'est toute la tragédie de l'homme qui est exprimée. L'auteur, celui qui reste, pleure un amour comme il pleure celui que le monde lui refuse. Dès lors, Seuls les oiseaux sont libres montre à quel point les relations humaines sont problématiques, souvent embuées dans l'incompréhension, le mépris ou l'indifférence. Le petit chat perdu symbolise tous les manques. Le recueil appelle à plus de compassion, de considération et d'amour. Par l'acte d'écriture, les principales problématiques sont exprimées, celles qui préexistent à toutes les relations humaines.
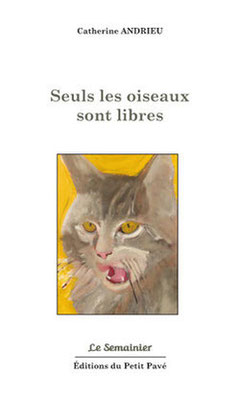
Nouvelles lunes précédé de Chaosmose
Second recueil paru aux Editions du Petit Pavé en 2014
Première partie : Chaosmose
Tout comme dans Un amour, le bord d’un canal, l’élément principal est l’eau. L’eau qui engloutit, qui ressuscite, double face du miroir qui sert à vivre. Zaha, « à la fois femme vivante et femme noyée qui ressurgit du passé », semble revenir d’un autre monde. Zaha dit « qu’elle est morte aux autres, au genre humain ». Dans ses nombreuses métamorphoses, Zaha-le-Corbeau est mystérieuse, se mêle aux étoiles, à l’univers. Zaha est « un peu étrange, effrayante parfois » et se réfugie dans le merveilleux : « Je te veux de tes neuf réincarnations auprès de moi, car la sorcière noire à besoin du vampire aux yeux maquillés. » Jacques Hold, « échappé d’un roman de Marguerite Duras » est « l’homme trou, l’homme rien, (…) ce que Lol.V. Stein cherchait : Dieu. » Zaha qui comptait se réfugier dans la légende du roi Arthur subit le même sort : «Une force étrange l’attire vers l’obscurité profonde où elle sent palpiter les forces de l’univers. » Rien ne subsiste dans ce monde. Toutes les identités se transforment, comme autant d’étoiles filantes. Car Zaha devient Christ, « tend les bras vers le ciel puis s’écroule terrassée par ses visions. » Zaha ne sait plus à quel Saint se vouer : « On cherchera longtemps Zaha parmi les arbres noirs. » C’est dans les étoiles que Zaha se sent à sa place, reprenant « le cycle éternel des années de la naissance à la mort, du néant à la résurrection.» Tout finit, tout se transforme. C’est à ce prix que vivre redevient acceptable. Ainsi s’en va « le nénuphar dansant » sur « les eaux de la rivière. »
Deuxième partie : Nouvelles lunes
I. La légende
Cet ensemble de poèmes se situe entre le rêve et la magie noire. On sait que les rêves nous plongent dans des aventures ; ici c’est de la légende arthurienne dont il est question. Le texte reprend les personnages de Morgane, Lancelot, Guenièvre… Les incantations, les visions sont nombreuses. Peut-être est-ce pour éviter l’épreuve de la putréfaction que l’auteur s’en remet à la magie et aux astres pour nous conter le monde onirique dont il est question ici : « Ce rayon de lune s’est-il subrepticement glissé dans son sang ? » N’est-ce pas pour échapper aux cauchemars que se plonger dans cette autre réalité ? Si les images sanglantes sont toujours présentes : « Un chien éventré hurle à la mort », c’est toujours le mystère de la lune changeante qui apaise les tensions. Comme dans le rêve, rien n’est toujours bien ou mal, agréable ou douloureux… Le rêve est un espace où il fait bon se réfugier… Tant que cela est possible ! Car quand le suicide d’une amie vient ternir le rêve et le réel, quand Isabelle devient Isabelle-le-Corbeau et déploie ses ailes, nul refuge n’est possible. Ce n’est que l’écriture comme relecture du rêve, la « nouvelle lune » qui permet d’exorciser le drame bien réel. Boire la coupe, c’est signer un pacte avec la mort. Le Graal, c’est le poème, l’acceptation que les choses soient, qu’elles évoluent, entre le réel et l’imaginaire. C’est l’acception de la fin et du recommencement.
II. D’ailleurs et d’aujourd’hui
Quand le poète cherche sa voie, il en vient à contempler son univers mental et son environnement. Ici, on oscille entre Paris et l’océan, entre le soleil couchant et l’hôpital psychiatrique, entre la mort et la réincarnation. Le poète qui souhaite aller au plus près des choses, affirme : « Qui n’a jamais Vu le soleil ne saurait poser son œil définitif sur le monde des ombres. » C’est en effet grâce à ce « don de double vue », tourné vers soi et au-delà de soi, que le voyant est à même de discerner l’essence-même des choses. Dès lors, la réalité est à la fois humaine et naturelle, ici et ailleurs, elle est le grand Tout, l’infiniment petit. Le poète lutte pour ne pas sombrer, se souvient souvent de l’hôpital psychiatrique : « Et ce sont les longs couloirs blancs et les trousseaux de clés. / Les cachets que j’absorbe. » L’avortement, le viol, la nécrophilie… Le corps de la femme est violemment mis à mal. Ce n’est que pour mieux souligner sa destinée de sang ! « J’étais un cadavre, et tu enfonçais encore ton œil », est-il dit dans Charogne. Comment briser le quotidien des « palpations » et des « électrochocs », des « questions sans réponses » et de « l’Haldol » ? Comment ne pas sombrer dans cet « ailleurs » qui nous attire à lui à chaque instant ? Ne serait-ce pas encore en l’évoquant dans l’écriture ? En souhaitant aussi revenir dans un « aujourd’hui » réconfortant ? Jour après jour, il faut combattre la peine, la souffrance, la maladie. Il faut une lueur issue des « fentes métalliques que la lune explose », des yeux d’un chat, pour retrouver le goût de vivre. Ainsi le poète a « signé un pacte » satanique - « Et je lèche le sang séché sur tes lèvres » - avec son compagnon. Face à la cruauté, à la lâcheté des hommes, le refuge qu’est ce petit animal devient un des seuls à agrémenter la journée. Quand paris devient « vénéneuse, noire noire si noire qu’elle tourne au vert d’absinthe », quand l’Ourcq se trouve « zigzagué du bleu sang des cadavres qu’il inonde », rien ne parvient plus à consoler le poète, qui en appelle à l’ « alcool », un breuvage en mesure de faire oublier le malheur. «Peut-on être possédé par un esprit qui n’a jamais existé ? » La condition humaine n’est-elle pas raccordée à une mélodie secrète et dangereuse ? Ce qui est identifié, assimilé, peut se combattre. La poésie est une arme. Cette lutte incessante propre à certains être sensibles, semble ne plus avoir de fin : « J’ai bu tous les poisons » affirme le poète dans un élan rimbaldien, et aussi : « J’ai bu le poison (…) / A même tes poignets tranchés », et encore : « J’essuie l’écume et le sang. » Ce qui console, ce qui guérit est un combat qui passe par l’écriture, quand celle-ci est possible. « L’idée vient que la mer bouge à la place de quelque chose d’autre » : l’écriture remplit une fonction bien particulière, elle est la vie-même, elle se charge de l’alpha et de l’oméga. Vouloir vivre, c’est accepter de ne plus écrire, d’avoir tout écrit. Qu’est-ce qui peut sauver alors, si l’écriture elle-même est un leurre ? « D’abord elle ne ressentit rien sinon une impression de vide », puis «elle vit en une seule et fulgurante image / (…) La mort » C’est dans le trépas que la vie trouve son sens : l’écriture est une clef pour ouvrir la porte de l’au-delà. Ensuite, c’est la vie, la survivance, que l’on doit le plus désirer. D’ailleurs et d’aujourd’hui nous propose à la fois une philosophie et une conception incandescente et poignante de la condition humaine. Ce n’est pas une vision morbide de la réalité, mais un appel à plus de vie. Certains dénigreront la violence du texte et ne comprendront pas la démarche poétique de l’auteur. C’est qu’ils auront mal lu l’œuvre de Catherine Andrieu.
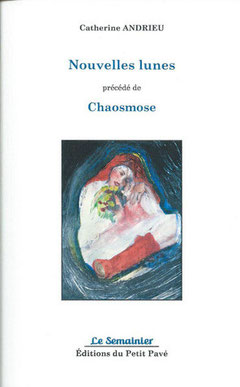
Poèmes de la Mémoire oraculaire
Premier recueil paru aux Editions du Petit Pavé en 2010
Première partie :
Ici, les mots sont à la fois taches de sang et taches de peinture : « Dessins rouges sillons sur mon corps ». Le corps-organe est travaillé au couteau, au sens propre : « Avez-vous mangé du foie, de la langue, du poumon [?] » C’est ainsi que des images que la morale qualifierait d’impures sont omniprésentes, habitent le poème : « Fil tranchant de ta mémoire d’eau de foutre. » Cette parole brute bannirait l’auteur de toute sépulture, de toute convention : « C’est bien connu, les cannibales n’ont pas de cimetière. » A la fois, le poète désire «sortir de [s]on tombeau de verre qui doucement glisse sur les eaux » et avoue : « Je cherche, plus que le néant, la pensée qui ne peut exister. » Quand la vie fait naufrage, le quotidien est hanté par l’apparition des morts, des suicidés, des malmenés par la vie. Le mot n’est plus un endroit où l’on se construit, mais où l’on se déconstruit : « Langues infectes sibyllines ses mains décapitées ma tête à ses genoux. » Il faut apprendre à ne pas parler, pour ressentir l’infatigable présence de ceux qui ont disparu… « Je me rappelle l’entrée en psychose », dit l’auteur, cette remise en cause que la vie parfois réserve à certains êtres fragiles. Ainsi, comme un ultime parjure, le poète affirme : « Je suis l’œuvre finie de mon créateur », c’est-à-dire ce que la vie, la nature et l’esprit ont réalisé de plus beau, de plus effrayant, de plus sincère. L’auteur puise ici au fond de l’inconscient, dans cette parole où la femme est en souffrance. Si la société condamne, si la maladie détruit, cette force de création qu’est le poème est plus que jamais au cœur de la vie.
Seconde partie : Un amour, le bord d’un canal
Chacun pourra lire et interpréter ce texte à sa façon. Je n’ai pas la prétention de détenir le sens psychologique du récit. Je sais simplement qu’il est violent, né dans la souffrance, et j’en connais toute la portée symbolique. Qui connaît le canal de l’Ourcq, ne peut plus voir cet endroit de la même façon. Car dans ce récit se joue un drame humain. Catleen est un être de papier et de mots, une âme perturbée, le produit d’une machine à écrire. Corée, lui, amant idéalisé, sait lire en elle, la voit peu à peu sombrer. Entre eux, le suicide d’une femme, Claire. La femme écrivain a trouvé en Catleen son double, un être qui va l’envahir jusqu’à la posséder tout à fait. Catleen entend des voix, devient autre, jusqu’à la folie, l’hôpital psychiatrique. Les passants dans ce récit représentent une autre entité : le lecteur. Ils voient cette femme folle prononcer des propos incohérents. De l’espace du papier à celui de la rue, c’est de l’identité même de l’écrivain dont il est question. Le lecteur ne peut atteindre que cette courte histoire ; comment préjuger de ce qui se joue au fond de l’inconscient ? L’écriture est un dédoublement. La fiction est bien plus facile à appréhender que la réalité. Catleen vit, possédée par le fantôme de Claire, par son imagination. L’écrivain trouve dans ce récit la part de merveilleux qui lui manque ; la vie réelle, elle, est chaotique, bien loin de cet imaginaire qui le hante. « La ville, c’est la mer », Catleen se noie à son tour pour disparaître du récit. Cette seconde partie des Poèmes de la Mémoire oraculaire, plonge au plus profond de la psychose, laissant un goût de sel, un sentiment de vertige, l’écho d’une voix authentique liée au dédoublement de l’auteur.
Troisième partie : Immersion
Cette pièce aurait pu être jouée au bon vieux temps du Surréalisme et aurait sans doute fait scandale. Aujourd’hui,
montrerait-on un homme nu, masqué face aux spectateurs ? Les images sexuelles sont nombreuses. Le complexe de castration, les propos que l’on qualifierait de crus… L’auteur ne s’embarrasse pas de
la pudeur, ne cherche pas à dissimuler, mais au contraire à montrer ce qu’une pièce vide d’hôpital psychiatrique peut réserver d’images violentes ! Ce qui ne se montre pas ailleurs nous est
révélé ici : « Petite pute : Et ma pommade ! Mais… comment je vais baiser si j’ai trop mal ? » Si la Folle dit : « Je travaille à rendre visibles les forces invisibles »… rien ne semble plus
pouvoir arrêter les visions et les voix ! « Les longs cheveux blonds emmêlés, le sang aux poignets comme des cordes qui se déroulent » L’absurde est au cœur de cette pièce, comme le sont la
violence des propos et les symboliques dévoilées. Ici, tout est mis en scène pour que le lecteur – spectateur – se sente déstabilisé et plongé dans un endroit où il ne serait pas allé
volontairement. Les visions de la Folle nous sont perceptibles, la folie nous est dévoilée de l’intérieur. L’infirmier joue son rôle de soignant, tourné un peu en dérision. « Quatre murs
qui n’ont jamais suffi à faire une pièce », dit la Voix… Ce qui se voit, ce qui s’exprime est au-delà de toute réalité. Le texte rejoint malgré tout les éléments autobiographiques. C’est un
fait peu commun, ignoré de tous car impossible à imaginer, que se trouver enfermé dans une chambre vide, sans fenêtre, dans un hôpital. Dans Immersion, l’écrivain dissèque son propre
cerveau. En guise de médicaments, « sur le plateau, un pinceau, un crâne et un miroir »… Seule l’écriture peut rendre compte de la folie traversée. Que l’on soit dans l’acte de création, dans la
neurasthénie ou dans la vie quotidienne, cet imaginaire se révèle parfois à notre propre insu. L’écriture donne une signification à ce qui ne peut être exprimé autrement. Cette pièce sans pudeur
en est un parfait exemple.

Catleen, le cœur à nu
(8 octobre 2009)
J’apprécie l’œuvre de Catherine Andrieu, alias Catleen, qui vient d’être censurée à Charleville-Mézières, et elle sait que je la soutiens. On traque désormais la pornographie dans les œuvres d’art mais on oublie celle du monde, celle de tous les jours dans les journaux, à la télévision. C’est que maintenant il ne faudrait plus montrer un sein, un bout de fesse et surtout pas avec la froideur du corps aliéné que seule la folie parvient à décrire ; il ne faudrait pas peindre, écrire, avec la souffrance du corps et la douleur de l’âme, avec ce que cette folie permet de percevoir, c’est-à-dire un au-delà de soi-même sans cesse oscillant entre éros et thanatos, entre l’impossibilité d’être et le désir de l’autre. Toutes les œuvres d’art ont été peintes par des hommes, il ne faudrait pas oublier cela avant de s’attaquer à quelqu’un, avant de dénigrer ses peintures. Il y aurait des génies – ceux admis par la critique et le temps – quant aux autres ils seraient soumis à la vindicte de la ménagère allant faire ses courses, ne représentant pas grand chose finalement… Il y aurait des catégories oscillant entre le génie et le fou ! Alors que nous sommes chacun sur un pied d’égalité entre nos angoisses, nos questionnements, nos souffrances. L’œuvre de Catleen est traversée par cette interrogation du corps, par ce rapport que l’on entretient avec soi-même, avec son éducation. Comment parvient-on à assumer l’ordre moral que renvoient les parents, la société, comment assumer ses différences, c’est bien la question que se pose en filigrane Catherine Andrieu à travers ses peintures. Mais la véritable pornographie n’est-elle pas dans cette publicité qui exploite une image de la femme en en faisant un objet de consommation ? N’est-ce pas celle de l’argent, opulent devant la misère des hommes ? Il y a quelque chose de malsain dans les leçons de morale que nous envoient ces esprits bien pensants. Il faut dire qu’une fesse est une fesse, qu’un corps est un corps, qu’un homme est un homme ! Se souvient-on d’Artaud criant « Pour en finir avec le jugement de Dieu » ? Et chacun n’est-il pas capable d’éteindre un poste de radio ? La pornographie, n’est-ce pas cette logorrhée journalière qu’on nous sert à la télévision et à laquelle nos enfants sont habitués sans que cela nous émeuve le moindre du monde ? Oh, cela n’est pas grand chose, une exposition, mais grande est la douleur apportée par des jugements qui s’abattent dans l’anonymat. Et c’est peut-être cela la morale de l’histoire : au-delà des procès intentés par les autres, savoir rester libre, le regard tourné vers le monde, comme Catleen, comme dans ses nus qui interrogent : et vous, quand transformerez-vous votre vie en une œuvre d’art ?
Daniel Brochard, peintre et poète.
